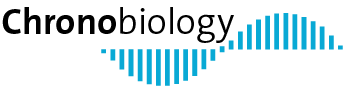Le sommeil est bon pour la santé – cette constatation générale est étayée par la science. Des études antérieures avaient déjà montré que les personnes qui dormaient après une vaccination avaient une réponse immunitaire en moyenne deux fois plus forte que les personnes qui ne dormaient pas la nuit suivant la vaccination. Toutefois, les raisons biologiques cellulaires de ce phénomène n’avaient guère été étudiées jusqu’à présent. Une équipe dirigée par le professeur Luciana Besedovsky de l’Institut de psychologie médicale vient de démontrer que le sommeil favorise la migration des cellules immunitaires – appelées lymphocytes T – vers les ganglions lymphatiques. Les chercheurs ont publié leurs résultats dans la revue « Brain, Behavior, and Immunity ».
Pourquoi le sommeil favorise la réponse immunitaire
Les scientifiques ont examiné à plusieurs reprises la concentration de différents sous-groupes de cellules T dans le sang d’une cohorte d’hommes et de femmes en bonne santé au cours de deux sessions de 24 heures. Dans l’une des deux conditions de test, les participants ont été autorisés à dormir pendant huit heures la nuit, tandis que dans l’autre, ils se sont détendus au lit la nuit mais sont restés éveillés. Un cathéter antécubital relié à une pièce voisine par un tube a permis de prélever du sang sans perturber le sommeil des participants. L’analyse des échantillons de sang a révélé des différences significatives entre les conditions de test : « Nos résultats montrent que le sommeil favorise le potentiel de migration de diverses sous-populations de cellules T », explique Besedovsky.

Les scientifiques ont identifié l’hormone de croissance et la prolactine comme des facteurs clés de ce comportement migratoire. Les deux hormones ont montré des changements de concentration plasmatique dépendant du sommeil, avec des niveaux plus élevés chez les participants qui avaient dormi la nuit. « Nos résultats ont également des implications cliniques potentielles », déclare Besedovsky. « Par exemple, l’hormone de croissance et la prolactine pourraient être considérées comme de nouveaux adjuvants pour promouvoir la réponse immunitaire après la vaccination, en particulier chez les personnes âgées, qui ont généralement des niveaux réduits de ces hormones pendant le sommeil. Dans l’ensemble, les auteurs considèrent cette étude comme une étape importante pour mieux comprendre pourquoi le sommeil favorise la réponse immunitaire, par exemple après une vaccination, et pourquoi les vaccins sont souvent moins efficaces chez les personnes âgées.
Stimuler le système immunitaire au bon moment
En décryptant les mécanismes de migration cellulaire qui sous-tendent la réponse immunitaire, des scientifiques de l’Université de Genève (UNIGE) en Suisse et de l’Université Ludwig Maximilian (LMU) en Allemagne ont montré que l’activation du système immunitaire est modulée en fonction de l’heure de la journée. En effet, la migration des cellules immunitaires de la peau vers les ganglions lymphatiques fluctue sur une période de 24 heures. La fonction immunitaire est maximale pendant la phase de repos, peu avant la reprise de l’activité – dans l’après-midi chez les souris, qui sont des animaux nocturnes, et au petit matin chez l’homme. Ces résultats, publiés dans la revue Nature Immunology, suggèrent qu’il pourrait être nécessaire de tenir compte du moment de la journée lors de l’administration de vaccins ou d’immunothérapies contre le cancer, afin d’en accroître l’efficacité.
Des données supplémentaires suggèrent également que la stimulation du système immunitaire à différents moments de la journée produit les mêmes fluctuations, avec un pic le matin. Mais pourquoi le système immunitaire est-il contrôlé par un rythme oscillant ? Les rythmes circadiens agissent comme un système d’économie d’énergie pour utiliser au mieux les ressources énergétiques en fonction des besoins les plus immédiats. Serait-ce un moyen pour le système immunitaire d’être en alerte aux moments où le risque d’exposition aux agents pathogènes est le plus élevé en raison de la consommation d’aliments et/ou des interactions sociales ? Pourrions-nous également être plus sensibles aux agents pathogènes le soir et la nuit ? Il est trop tôt pour le dire. Quoi qu’il en soit, l’importance du rythme circadien pour le système immunitaire vient tout juste d’être découverte et pourrait revêtir une grande importance pour la vaccination préventive, l’administration de thérapies antitumorales et le traitement des maladies auto-immunes.